Jean-Claude Larronde
Izan,
un collectif abertzale
au
tournant des années 1980
par Jean-Claude
Larronde
A
la fin des années 1970, a vu le jour en Iparralde un groupe de
militants qui prit le nom de Izan et s’auto-définissait
comme «Collectif abertzale autogestionnaire» ; ce
groupe eut une action politique jusqu’au début de l’année 1984.
Après
avoir rendu hommage aux militants aujourd’hui disparus d’Izan, en
particulier Michel Burucoa, Jean Idieder, Jean Espilondo (de Bidart)
et Eñaut Larralde, je mentionnerai les principaux leaders :
Jakes Abeberry (sur le plan politique) et Patxi Noblia (sur le plan
économique).
A
l’automne 1978, le panorama abertzale était loin d’être
satisfaisant pour ceux qui allaient être les fondateurs de ce
groupe : on distinguait un mouvement socialiste EHAS jugé
quelque peu sectaire et qui avait enregistré un score électoral
très faible aux législatives du mois de mars dernier (3,6% des
suffrages exprimés), des militants très radicaux qualifiés comme
« le courant du refus », et un courant prônant la
violence, Iparretarrak. En résumé, l’expression du courant
abertzale était jugée sans grande prise sur la réalité,
relativement inefficace et peu crédible. Un vide était ressenti.
Des « Assises abertzale » furent convoquées
pour le dimanche 29 octobre 1978 à Ustaritz (Landagoyen) avec trois
objectifs : limiter l’éparpillement des énergies ;
coordonner les « indépendants » et « inorganisés »
et améliorer l’efficacité abertzale sur les plans économique,
culturel et politique. Deux militants, parmi ceux à l’origine de
cette réunion —qui réunit 115 personnes— Patxi Noblia et
Ramuntxo Camblong expliquaient dans Enbata : « Au
lieu de parler organisation ou parti, on dit problèmes qui se
posent à nous et solutions qui peuvent se trouver et à partir
de là essayons d’établir l’organisation qu’il faudra,
organisation qui n’a rien à voir avec une forme de
mouvement ou de parti ».
Après
plusieurs réunions auxquelles participèrent près de 200 personnes,
le projet fut présenté lors d’une conférence de presse début
janvier 1979 à Bayonne animée par Henri Duhau, Jean Roch Guiresse,
Mikel Ithurbide, Patxi Noblia, Eñaut Larralde et Jean Espilondo.
Puis, le dimanche 28 janvier 1979 au restaurant Chilbendea de
Hasparren, une assemblée de 80 personnes décida de créer Izan.
Izan ne se voulait pas un mouvement, encore moins un parti politique,
mais une structure de travail provisoire qui permettait à ses
militants la double appartenance, par exemple avec d’autres
organisations abertzale (mais on peut remarquer que cette double
appartenance ne trouva guère à s’appliquer, en tous cas pas avec
des mouvements abertzale) ; cette structure de travail entendait
enclencher un faisceau de «micro réalisations qui
additionnées, engagent le peuple basque dans la voie de sa
libération pour ce qui concerne son identité, sa langue ou
son économie».
Izan
se voulait autogestionnaire, c'est-à-dire que ce collectif entendait
donner la parole et le pouvoir de décision à la base, chacun devant
se prendre en charge à chaque échelon de la structure de travail,
mais les responsables tireront un bilan négatif de cet objectif car
le groupe local prévu, le Lan Talde, de 4 à 10 personnes, s’avérera
un échec ; seul le Lan Talde du BAB sous la direction efficace
de Michel Burucoa aura une existence effective.
Izan
fonctionna avec un Bureau, le Biltzar Ttipi, prévu à l’origine
pour 5 membres mais qui sera vite élargi et qui se réunira assez
régulièrement tous les quinze jours ; les membres de ce Biltar
Ttipi : Jakes Abeberry, Jean Espilondo, Jean Idieder, Mikel
Ithurbide, Eñaut Larralde, Jean-Claude Larronde, Patxi Noblia,
Philippe Oyhamburu, Urtxoa Parot. Huit hommes, une femme !… A
Izan, la parité n’était pas encore à l’ordre du jour !...
L’Assemblée Générale des adhérents (le Biltzar Nausi) devait
se réunir deux fois par an.
Izan
se dota d’un local à Bayonne, au 11 rue Bourgneuf (1er
étage) à partir de mars 1979 avec un téléphone et une « offset »
—instrument obsolète aujourd’hui pour les jeunes générations !—
ensuite le local fut transféré toujours à Bayonne, au 17 rue
Pontrique (3e étage) à partir de décembre 1980.
Izan
se dota surtout d’un permanent en la personne de Jean-Louis
Harignordoquy, « Laka », de Baigorri qui commença à
travailler à partir du 15 mars 1979. Tous les responsables d’Izan,
tous les rédacteurs du Bulletin Intérieur Izan Hitzak
insisteront sur l’énorme travail extrêmement important accompli
par ce permanent, qualifié par Patxi Noblia de « super-permanent »
; quelques chiffres traduisent l’impressionnant travail de
Jean-Louis Harignordoquy : durant les premiers six mois suivant
son recrutement, il avait visité 234 personnes et adressé 5000
lettres. Le recours à un permanent était, à l’époque, inédit
au sein du mouvement abertzale, même si cette pratique se
généralisera plus tard.
Un
bulletin d’information ayant pour nom Izan Hitzak était
édité ; il aura 22 numéros ; le premier numéro sortira
en décembre 1979 ; il y aura 8 numéros en 1980, 6 en 1981, 4
en 1982 et 3 en 1983. Ce bulletin sera adressé à 250 personnes
environ.
Au
point de vue financier, il avait été décidé que les cotisations
devaient couvrir le salaire du permanent qui était payé au SMIC et
les charges sociales ; le chiffre de 1% des revenus avait été
donné aux cotisants à titre indicatif ; de 70 cotisants en
juin 1980, le chiffre tomba à 50 en décembre de la même année et
sans doute beaucoup moins par la suite si l’on se fie à un article
de Jean Idieder qui relève dans le numéro 13 d’ Izan
Hitzak de mai 1981 que « les cotisations ne
rentrent pas. » Les besoins de trésorerie étaient estimés à
un minimum de 6000 francs par mois. Il faut dire que le permanent
recueillait régulièrement de l’argent pour financer le groupe
auprès des personnes qu’il visitait. Plus tard, Jean-Louis
Harignordoquy sera le permanent salarié de l’association Hemen.
Dès
son origine en 1979-1980, Izan mit en avant cinq chantiers- phares :
1°)
La revendication institutionnelle : un département Pays Basque
doté d’un Statut de la Langue et de la Culture basques ;
2°)
La présence abertzale aux élections municipales en Iparralde :
la démarche Herritarki ;
3°)
Le développement économique : le Plan 1500 emplois d’ici à
1985 ; la naissance de l’association Hemen et de la Société
Anonyme Herrikoa ;
4°)
Les échanges transfrontaliers : Le Jumelage Populaire Bayonne-
Pampelune et la création de l’association Iruña ;
5°)
Au niveau culturel : l’association Ereileak, Fédération des
artistes, intellectuels et animateurs culturels basques.
La
revendication institutionnelle : un département Pays Basque
doté d’un Statut de la langue et de la culture
basques
L’étape
du référendum
Izan
naquit dans les années du giscardisme finissant ; un projet de
loi visant à populariser le référendum communal d’initiative
populaire avait été voté par le Sénat ; encore fallait-il
qu’il soit adopté par l’Assemblée Nationale.
Une
assemblée convoquée par Izan se tint au Trinquet Berria de
Hasparren le 23 novembre 1979 et réunit près d’une centaine de
personnes ; elle décida à l’unanimité moins deux voix et
quatre abstentions de porter le débat sur le département Pays
Basque au sein même de la population des villes et des campagnes ;
il s’agissait d’organiser dans un maximum de communes –là en
principe où les maires étaient d’accord pour prendre en charge le
scrutin- une consultation populaire sur le thème : « Pour
ou contre la création d’un département Pays Basque doté d’un
statut de la Langue et de la Culture basques ».
Une
commission de travail d’Izan œuvrera dans ce sens de décembre
1979 à juin 1980 ; cette commission tiendra de nombreuses
réunions et accomplira un travail important ; elle se
rapprochera de « l’Association pour la création d’un
Nouveau Département » —AND— qui avait été créée en
1975 et qui était présidée par Albert Viala, maire d’Arcangues
et animée par Jacques Saint-Martin, Président de la CCI de Bayonne
et par le professeur Jean Haritschelhar ; au printemps 1976,
cette association revendiquait 700 adhérents dont 45 maires, mais
ses demandes de renseignements à l’Administration départementale
sur certains aspects financiers se heurtaient à un mépris de plus
en plus affiché du Préfet.
La
Commission d’Izan rédigera un argumentaire général, un
historique de la revendication du département Pays Basque depuis
l’époque des frères Garat, des études sur l’aspect juridique
du référendum et sur l’impact socio-économique, recueillera des
témoignages sur l’émotion suscitée par la fermeture de la
sous-préfecture de Mauléon en 1926 et la suppression du Tribunal de
Première Instance de Saint-Palais en 1955 ; elle insistera sur
le fait que la Soule était détachée de la CCI de Bayonne et sur la
fiscalité départementale. Cette Commission prit aussi des contacts
politiques avec les groupes abertzale d’Iparralde, EHAS, Herri
Talde et Ezker Berri (on ne peut pas dire que l’enthousiasme fut
délirant de la part de ces interlocuteurs !) mais aussi —et
cela était nouveau pour le mouvement abertzale— avec des partis
politiques hexagonaux : contacts avec le Parti Socialiste
facilités par Antxon Lafont, directeur à la CCI de Bayonne,
militant à l’époque du PS et d’Izan ( il est à noter que deux
autres militants d’Izan, Claude Harlouchet et Maurice Borthayrou
avaient la carte du Parti Socialiste ; il furent fortement
encouragés par Jakes Abeberry à la conserver pour le moment !) ;
ces contacts avec le PS furent établis avec Christian Laurissergues,
député du Lot-et-Garonne et délégué général du PS aux
Identités Régionales, basque par sa mère, et avec le PS Côte
Basque représenté notamment par André Tassy, Jean-Pierre Destrade
et Nicole Péry ; des contacts furent pris aussi avec le Parti
Républicain ou encore avec une forte délégation du CDS local chez
Didier Borotra (Didier Borotra, Bernard Darretche, Pierre Létamendia,
Michel Labéguerie et Michel Epherre). Chaque fois, l’entrevue fut
cordiale mais le projet de consultation populaire rencontrait des
avis plus mitigés que le Plan 1500 emplois présenté par la même
occasion et qui lui, recueillait une large approbation. Le nom des
militants d’Izan, différents chaque fois, qui participèrent à
ces rencontres : Jakes Abeberry, Jean Espilondo, Antxon Lafont
,Patxi Noblia, Ramuntxo Camblong, Iñaki Hernandorena, Mikel
Ithurbide, Jean-Roch Guiresse, Christian Laprérie et moi-même.
Jakes Abeberry était pratiquement de toutes les réunions.
De
nombreux maires furent approchés, les contacts étant facilités par
Marie-Andrée Arbelbide, maire de Hélette, par Paul Dutounier, maire
de Sare et Président du Biltzar des maires du Labourd et surtout par
Michel Berger, maire de Villefranque, présent à de nombreuses
réunions comme à la mairie de Tardets en avril 1980 pour une
réunion avec des maires souletins. Izan recueillit les signataires
de ces maires qui se déclaraient en faveur de ce référendum ;
Izan initia une campagne de signatures de ces maires mais aussi de
sportifs (joueurs de rugby et de football, pilotaris), d’académiciens
basques, de prêtres, de syndicalistes ouvriers et agricoles).
L’Association
des Elus pour un département Pays Basque
Après
ce travail important, le terrain était largement déblayé pour la
création de « l’Association des élus pour un département
Pays basque » qui verra le jour le 21 juin 1980 lors d’une
Assemblée Générale Constitutive à la mairie de Macaye à laquelle
assistèrent au nom d’Izan, Jakes Abeberry et moi-même. Aux termes
de l’article 1 des Statuts, il s’agissait de « préparer
les conditions favorables à l’organisation de tous types de
consultations populaires permettant aux habitants des différentes
communes de se prononcer sur la création d’un département Pays
basque, doté de statuts des langues et cultures locales ».
41 maires adhéraient à cette Association dont le siège était fixé
à la mairie de Hélette. La présentation de cette association eut
lieu le 8 juillet 1980 lors d’une Conférence de presse à Mauléon
dans une salle de classe préfabriquée d’une école de quartier
accordée par la mairie ; cela reflétait assez la froideur avec
laquelle ce projet était reçu en Soule. Animèrent cette Conférence
de presse, Andde Luberriaga, maire d’Ascain et Conseiller Général
du Canton d’Ustaritz, Paul Dutournier, Michel Berger et Jean-Pierre
Larramendy, adjoint au maire de Hasparren.
Les
réactions hostiles à cette initiative ne se firent pas attendre :
parmi celles-ci, on peut citer Victor Mendiboure, maire d’Anglet,
qui qualifia le projet d’ « irréaliste » ;
le Préfet, qui écrivit une lettre menaçante à tous les maires
membres de l’association ; le RPR ( ses parlementaires, le
Président du Conseil Général Frantz Duboscq et le Bureau
Départemental) qui jugea le projet rien moins que « suicidaire » ;
Henri Grenet, maire de Bayonne, qui maintenant se déclarait partisan
d’une région de l’Adour comprenant un département regroupant
les trois provinces basques et l’arrondissement de Dax ; le
ministre de l’Intérieur Christian Bonnet qui, lors d’une visite
à Oloron au début de mars 1981, s’opposa au département « dit
basque » ; le candidat à sa réélection à la présidence
de la République, Valéry Giscard d’Estaing qui déclara quelques
jours avant le scrutin de mai 1981 : « La vitalité
d’une culture et la reconnaissance d’une identité ne
passent pas nécessairement par la modification d’un cadre
administratif ».Toutes ces réactions hostiles
n’empêchaient pas plus de 150 élus d’adhérer à cette
association.
Concernant
cette Association des élus, on peut noter que Jean Aniotzbehere,
nouveau maire de Sare fut élu à sa tête en juillet 1983 en
remplacement de Michel Berger, qu’elle joua un grand rôle dans
l’organisation du vote du Biltzar des maires en faveur d’un
département Pays Basque (à 64% en octobre 1996) et qu’elle existe
toujours, présidée par Sauveur Bacho, maire d’Arberats.
L’élection
de François Mitterrand à la Présidence de la République et de
Jean-Pierre Destrade comme député de la Côte Basque
Le
10 mai 1981, l’élection de François Mitterrand à la Présidence
de la République puis le 21 juin, celle de Jean-Pierre Destrade
comme député de la Côte Basque allaient changer la donne
politique.
Surtout
que depuis plusieurs mois, on avait noté une évolution notable du
Parti Socialiste dans le cadre de sa philosophie générale du
« droit à la différence ». « La proposition de
loi portant création d’un département Pays Basque »
présentée par tous les membres du groupe socialiste et apparentés,
était enregistrée à la présidence de l’Assemblée Nationale le
18 décembre 1980. L’exposé des motifs indiquait : « Prenant
en compte la nécessité de rendre sa dignité et sa culture au
peuple basque de France…le Parti Socialiste estime nécessaire
que soit créé un département nouveau portant le nom de Pays
basque. » François Mitterrand —en tant que député—
était signataire de cette proposition dont le principal artisan
était Christian Laurissergues. Il serait intéressant de demander
aujourd’hui à Jean-Yves Le Drian, actuel ministre de la Défense
s’il se souvient d’avoir été le signataire de cette proposition
de loi. A mon sens, il est inutile de poser la même question à
Henri Emmanuelli, autre signataire ; il est sûr qu’il a
complètement oublié cela.
Cependant,
au début mars 1981, au cours d’une réunion à Anglet, Christian
Laurissergues, Nicole Péry et Jean-Pierre Destrade déclaraient que
le référendum prévu était « anticonstitutionnel ».
Izan en conséquence mettait tous ses espoirs dans une victoire
socialiste à la présidentielle et abandonnait de fait, l’idée de
référendum qu’il avait portée jusque là.
Dans
le cadre de sa campagne, le candidat François Mitterrand s’engagea
nettement : d’une part, parmi ses « 110
propositions pour la France », la proposition 54
énonçait : « Un département Pays basque sera
créé » et d’autre part, il écrivit une lettre personnelle
aux présidents des deux associations militant pour le département
Pays Basque dans laquelle il déclarait qu’il ne pouvait être que
favorable à cette initiative.
Sur
le plan culturel, on notait la proposition de loi du député
socialiste Louis Le Pensec concernant la place « des langues et
cultures des peuples de France » d’avril 1981 et la
proposition 56 de Mitterrand : « La promotion des
identités régionales sera encouragée. Les langues et les cultures
minoritaires respectées et enseignées ».
S’appuyant
sur toutes ces bonnes intentions, un groupe de 40 abertzale, pour la
plupart militants d’Izan, appelèrent dans Enbata à voter
pour Mitterrand puis pour Destrade.
Après
l’élection de Mitterrand puis la majorité absolue obtenue par le
Parti Socialiste à l’Assemblée Nationale, les conditions
paraissaient extrêmement favorables pour la création de ce
département réclamé par les Basques depuis deux siècles. Izan
allait-il toucher son but ? Il décidait en tous cas de rester
vigilant.
Hitza
Hitz, Comité de vigilance et de dialogue
Le
20 août 1981, le groupe des 40 abertzale, réuni à Hasparren,
décida de se constituer en Comité de vigilance et de dialogue ayant
pour nom : « Hitza Hitz » et élit un Bureau
Provisoire composé de Ramuntxo Camblong, Daniel Landart, Argitxu
Noblia et Jean-Louis Harignordoquy ; les interlocuteurs étaient
désignés : Jean-Pierre Destrade, le Comité directeur PS du
Pays Basque, Christian Laurissergues.
Hitza
Hitz rencontrera à diverses reprises ces interlocuteurs mais sans
constater aucune avancée. Le 11 mars 1982, au Relais International
de Saint-Jean-de-Luz, Hitza Hitz avait invité les candidats du PS
aux cantonales pour un dîner-débat ; les membres présents
entendront Frantxua Maitia leur déclarer sans rire : « Nous
sommes prêts à traduire Gaston Defferre (Ministre de
l’Intérieur qui avait dit non au département Pays Basque)
devant la Commission des conflits…Lorsqu’il y a
conflit entre le Parti et le Gouvernement, il fait l’objet
d’un examen par une Commission mixte et le dernier mot appartient
au parti… Un militant socialiste ne peut accepter que le
Ministre de l’Intérieur traite ce problème selon sa bonne
humeur… »
Malgré
le peu de résultats obtenus du Pouvoir quant à la mise en œuvre
des réformes promises au Pays Basque concernant le département (
pas de délégué interministériel nommé, pas de «M. Pays Basque»
nommé à l’instar de ce qui s’était fait pour la Corse), mais
aussi sur le plan des ikastolas qui étaient dans une situation
financière catastrophique et sur le plan des réfugiés (qui
n’avaient pas vu leur statut de réfugié politique rétabli ;
il avait été supprimé par Giscard en juin 1978), le groupe des 40
abertzale appelait à voter pour les cantonales de mars 1982 en
faveur des candidats du PS et dans le nouveau canton de Saint Pierre
d’Irube en faveur de Michel Berger. Ces élections cantonales
verront d’ailleurs un raz de marée de la droite, seul le canton de
Bayonne Nord restant aux mains de la gauche.
L’attentat
de Baigorri qui verra la mort de deux CRS attirera ce communiqué de
la part de Hitza Hitz : « L’acte de folie
meurtrière de vendredi soir 19 mars 1982 à Baigorri, d’où qu’il
vienne, nous apparaît comme une provocation grossière,
inadmissible dans la situation actuelle du Pays Basque ».
Une
demande d’audience à François Mitterrand en octobre 1982, puis
une autre au début de 1983 ne recevront aucune réponse ; une
délégation d’Hitza Hitz sera simplement reçue le 18 janvier 1983
à l’Elysée par le sénateur Charasse, conseiller de François
Mitterrand ; ce sera pour s’entendre dire des banalités qui
avaient dû lui être soufflées par le Préfet, du genre : « Les
Basques sont minoritaires en Pays Basque » ou encore « Bayonne
n’est pas en Pays Basque ».
Hitza
Hitz enverra encore une lettre au PS du Pays Basque en octobre 1983,
dans la perspective du Congrès du PS à Bourg-en-Bresse pour lui
rappeler que « seule de l’ensemble de la proposition 54
des 110 propositions pour la France, la réforme basque est
restée lettre morte » mais le cœur n’y était plus et
le 3 février 1984, au local d’Izan de la rue Pontrique, Hitza Hitz
constatait : « A mi-parcours de la législature, sans
nier quelques avancées, la désillusion est grande ».
De plus, depuis quelques semaines, 6 réfugiés basques avaient été
expulsés au Panama et 41 réfugiés étaient en grève de la faim à
la Cathédrale de Bayonne. Hitza Hitz ne pouvait que constater la
rupture de la parole donnée et partant, ne pouvait que décider sa
dissolution.
Les
réponses du pouvoir
Sur
le plan de la création du département, il est inutile de revenir en
détail sur cette question qui est bien connue : rappelons
brièvement le titre à la une de Sud Ouest du samedi 9
février 1982 : « Gaston Defferre à Sud Ouest : Non
au département basque ». Le ministre de l’Intérieur et de
la Décentralisation nuancera en disant : « Je veux
encore réfléchir à ce problème, voir comment on peut engager
mon action, quelle méthode adopter » ; n’empêche
qu’il avait bel et bien déclaré à Sud Ouest : « La
solution ne sera pas fournie par la création d’un département
basque ». Le 23 février 1982, Gaston Defferre reçut Place
Beauvau une délégation du Pays Basque composée tout à la fois de
partisans mais aussi d’adversaires résolus du département.
Clémenceau disait : « Quand on veut enterrer un problème,
on crée une commission » ; Gaston Defferre lui, après
cette entrevue, créa une Mission Interministérielle pour le Pays
Basque, la Mission Ravail, du nom d’un inspecteur de
l’Administration au Ministère de l’Intérieur. Cette Mission qui
vint au Pays Basque en mai 1982 remit au ministre un rapport qui
préconisait la création d’un Conseil de Développement du Pays
Basque, création qui d’ailleurs se heurta dans un premier temps à
la mauvaise volonté de la majorité de droite du Conseil Général
des Pyrénées-Atlantiques. Le Comité Hitza Hitz avait opportunément
mais sans résultat rappelé à la Mission Ravail : «Une
simple déconcentration sur Bayonne serait contraire à
l’esprit de la décentralisation de l’actuel pouvoir».
Sur
le plan culturel, des «Assises de la Culture basque» avaient eu
lieu à partir de septembre 1981 au Musée Basque pour rédiger le
Statut de la Langue et de la Culture Basques qu’entendait mettre en
place l’Association des Elus ; 4 commissions furent créées :
mass media, patrimoine, structures et stratégie, enseignement. Une
délégation des Assises fut reçue en mars 1982 par un obscur Chargé
de mission à la Présidence de la République. Là encore, on
restait bien en deçà des espoirs, d’autant que le rapport d’Henri
Giordan remis à Jack Lang, Ministre de la Culture en février 1982
et intitulé « Démocratie culturelle et Droit à la
différence » contenait cette phrase : « Nous
plaiderons en faveur de l’adoption d’un principe de réparation
historique vis-à-vis des langues et cultures minoritaires. »
De simples vœux pieux, de bonnes paroles… Du moins, en avril 1984,
eut lieu un regroupement de 25 associations culturelles basques sous
le nom de « Pizkundea » avec pour président Jean
Haritschelhar et secrétaire général, Jakes Abeberry et deux mois
plus tard, un Centre Culturel du Pays Basque était créé avec comme
président Ramuntxo Camblong, auquel on avait eu la délicatesse
d’adjoindre comme vice-présidents, les enthousiastes de la culture
basque qu’étaient le préfet des Pyrénées- Atlantiques et le
conseiller général de Hasparren, Jacky Coumet.
La
présence abertzale aux élections municipales en Iparralde : la
démarche Herritarki en vue des municipales de 1983.
Dans
le numéro 10 d’Izan Hitzak, de janvier 1981, Jakes Abeberry
écrira un article intitulé : « Pour une stratégie
municipale ». Il posait la question de savoir si une stratégie
municipale abertzale était envisageable pour l’ensemble du Pays
Basque Nord pour les municipales de 1983. S’y prendre plus de deux
ans à l’avance pour préparer des élections était quelque chose
de tout à fait inédit au sein du mouvement abertzale où les
décisions de se présenter aux élections (jusque là aux
législatives et cantonales), qu’il s’agisse du mouvement Enbata
ou de EHAS, étaient souvent prises peu de temps avant les élections,
quand ce n’était pas à la dernière minute.
Deux
mois plus tard, dans le numéro 12 d’Izan Hitzak, Jakes
Abeberry entra dans le vif du sujet avec un article intitulé : « Les
municipales ». Il indiqua que des contacts avaient déjà été
pris avec des mouvements abertzale : le dialogue avait été
positif avec Ezker Berri (groupe de jeunes mené par Ellande
Duny-Pétré, qui éditait la revue Gernika) ; Herri
Talde avait répondu qu’il réfléchirait plus tard ; EHAS
n’avait pas répondu. Il souligna l’esprit de la
démarche « souple et solidaire » et informa que la
campagne de sensibilisation d’Izan commencera le 15 avril ;
trois zones étaient ciblées : le monde rural (Haute-Soule,
Basse-Soule, Ostibarret) ; la zone intermédiaire (Ascain, Sare,
Saint-Pée) et le monde urbain avec notamment les municipalités
d’Hendaye (tenue par la gauche) et de Biarritz (tenue par la
droite) ; puis il brossa les grandes lignes d’un programme
minimum de gestion municipale Herritarki concernant la culture basque
(à laquelle 1% du budget municipal devait être affecté),
l’économie, les médias, la démocratie communale, l’organisation
administrative départementale et les relations avec le Pays Basque
Sud.
D’avril
à novembre 1981, de nombreuses réunions d’informations d’Izan
eurent lieu pour expliquer la démarche Herritarki : à
Saint-Pée, Sare, Ostabat, Saint-Palais, Biarritz, Hendaye,
Espelette, Bayonne, Bidart, Arbonne, Ahetze, Guéthary, Arcangues,
Bassussary, Anglet, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Garazi, Tardets,
Sauguis, Camou-Cihigue, dans le Bas-Adour et à Hasparren ; au
total, plus de 300 personnes participèrent à ces réunions. Le
principal enseignement qui s’en dégageait était que tout le monde
avait senti la nécessité de bâtir une stratégie municipale sur
les trois provinces, même si cette présence devait prendre des
formes multiples en fonction des situations locales.
Des
« Assises municipales » eurent lieu au Trinquet Berria de
Hasparren le 9 janvier 1982 : 60 personnes sont présentes et il
y a 40 excusés. Une présence basque aux municipales qui s’appellera
« Herritarki » fut adoptée et une structure de
coordination et d’information fut élue ; une délégation
provisoire de 11 membres fut également élue.
Malgré
un gros travail sur le terrain, les résultats des municipales de
mars 1983 —qui virent en Pays Basque un fort retour du
conservatisme— ne furent pas très brillants pour Herritarki.
A
Bayonne, une liste « Bayonne-Capitale, Baiona Herri Nagusi »
menée par Claude Harlouchet et soutenue par le PSU recueillait 833
voix et 4,49% des suffrages exprimés ; il manquait 95 voix à
Claude Harlouchet pour dépasser le seuil de 5% des suffrages
exprimés et être élu ; à noter que c’était la première
fois qu’une liste basque se présentait aux élections municipales
à Bayonne.
A
Urrugne, une liste Herritarrak obtint 10% des voix ; sa tête de
liste, Danielle Pilotte, fut élue.
A
part cela, quelques abertzale étaient élus sur des listes de gauche
comme Maurice Borthayrou à Anglet, Kotte Ezenarro —sans doute plus
abertzale à l’époque qu’il ne l’est aujourd’hui !—
Jean Calbete et Martine Molle à Hendaye et Benito Zubeldia à
Saint-Jean-de-Luz.
Si
Marie-Andrée Arbelbide conservait sa mairie de Hélette, Michel
Berger (qui avait intégré dans sa liste Ramuntxo Camblong,
directeur de la Scop Copelec) était battu à Villefranque de même
que Andde Darraidou à Espelette ; à Biarritz, quatre abertzale
menés par Jakes Abeberry avaient intégré la liste socialiste menée
par le député Jean-Pierre Destrade, liste qui subit une lourde
défaite face à la liste du maire sortant Bernard Marie et de son
premier adjoint, Didier Borotra ; de même à Saint-Pierre
d’Irube, la liste de gauche- au sein de laquelle se présentaient
Alain Iriart —dont c’était la première apparition électorale—,
Philippe Lerat et Jean-Pierre Seiliez, ancien Président de Seaska-
était lourdement défaite.
On
ne peut pas dire que le coup d’essai de « Herritarki »
avait été en 1983 un coup de maître ; le numéro 21 d’Izan
Hitzak d’avril 1982 —dont les 16 pages sont consacrées au
bilan de ces municipales— le constate amèrement : « Donc
malgré les initiatives préalables (dès le début 1981) de
coordination avec Ehas et Herri Talde, il n’y a pas eu sur le
terrain d’unité dynamique et sans réserves… Surtout,
l’étiquette « abertzalisme modéré »,
« notabilisme abertzale » a continué de se répandre
complaisamment tout au long de l’année 1982, à propos de la
démarche Herritarki … Il est cependant temps de dire :
stop ! Mais qui sera capable d’arrêter cette guéguerre
castrant la majorité des abertzale… »
Du
moins dans le camp abertzale, beaucoup avaient fait leur,
l’affirmation martelée depuis deux ans par Izan, à savoir :
« Le pouvoir municipal est celui qui est perçu le plus
directement par l’électeur, celui qui est le plus proche du
citoyen ; les orientations de la municipalité touchent le
citoyen dans sa vie de tous les jours ». Herritarki
avait eu le mérite d’initier un mouvement et les élections
municipales suivantes marqueront pour les abertzale de notables
avancées.
Le
Plan 1500 emplois d’ici à 1985 : la naissance de
l’association Hemen et de la Société Anonyme Herrikoa
Avec
le volet économique, Izan a enclenché sans nul doute sa plus grande
réussite, un mouvement qui ira crescendo jusqu’à aujourd’hui,
avec des résultats brillants et encourageants même si dans les
toutes premières années, ceux-ci restaient pour les fondateurs en
deçà de leurs espérances.
Le
28 janvier 1979, lors de la fondation d’Izan, est approuvé le Plan
1500 emplois qui avait été concocté par les fondateurs au premier
rang desquels Patxi Noblia et Jean Idieder. De quoi s’agissait-il ?
Plusieurs constats étaient faits : à l’époque, le chômage
touchait en Pays Basque 8% de la population ; l’emploi était
sous rémunéré ; les entreprises importantes dépendaient de
centres de décisions extérieurs ; la condition nécessaire à
l’emploi était le capital ; l’épargne locale représentait
en 1979, 6 milliards de francs ; la moitié de cette épargne
était investie hors du Pays Basque. Le but était de mobiliser une
très faible partie de cette épargne basque pour l’affecter à la
création d’emplois en Pays Basque. Les objectifs de départ
étaient de 1000 souscripteurs et de 5 millions de francs. Les
objectifs pour 1985 étaient de 1500 emplois avec l’apport de 5000
actionnaires apportant 20 millions de francs.
Dans
la foulée de Hasparren, un Centre d’Etudes et de Recherches Socio
Economiques Basques (CERSEB) sous la présidence de Beñat Dassance,
maire d’Ustaritz, fut créé qui enregistra d’emblée l’adhésion
de 28 municipalités. Puis en août 1979, naquit une association :
Hemen avec Andde Darraidou comme président ; Hemen définissait
ainsi les deux axes de sa démarche : nous prendre en charge
nous-mêmes pour contribuer à la création de postes de travail ;
contribuer à l’instauration d’un esprit collectif de solidarité
et de développement. Des correspondants locaux furent mis en place ;
ils animèrent de nombreuses réunions. Le Plan 1500 emplois est
lancé en juin 1979. On se donna un an pour arriver aux objectifs ;
à l’époque, la loi Monory permettait pour les souscriptions en
capital, une réduction du revenu imposable de 5000 francs par
personne.
Au
30 juin 1980, malgré la mobilisation de plus de 300 personnes, seuls
304 souscripteurs avaient répondu, représentant un capital de
1.451.000 francs (c’était en capital un peu moins du tiers de ce
qui avait été prévu). L’assemblée Générale de Hemen le 9
juillet à Hasparren décida de prolonger le délai de travail
jusqu’au 31 octobre 1980 pour rassembler des promesses
d’engagements supplémentaires. Grâce à un travail intense des
militants durant tout l’été, à l’automne 1980, la Société
Anonyme Herrikoa put être constituée avec 699 actionnaires (donc,
69,9% de l’objectif et un capital de 2 580 000 Francs
(soit 51,6% de l’objectif). Les responsables jugèrent que le verre
était à moitié plein plutôt qu’à moitié vide et décidèrent
de tenter l’aventure. On constatait que si Baigorri et la Soule
avaient bien répondu, par contre les apports du BAB, de la Côte et
de Garazi avaient été très faibles. Dans le numéro 8 d’ Izan
Hitzak , de septembre 1980, Patxi Noblia relevait que seules
12 entreprises avaient jusqu’alors souscrit, ce qui était un
résultat décevant, et que les militants de EHAS et des Herri Talde
avaient été absents de la campagne de mobilisation.
Le
20 novembre 1979, les fondateurs de Herrikoa qui signèrent les
premiers statuts étaient : Ramuntxo Camblong, Andde Darraidou, Jean
Roch Guiresse, Mikel Ithurbide, Philippe Lerat et Patxi Noblia.
L’apport de la Société Anonyme Sokoa fut déterminant dans cette
fondation.
Le
premier Conseil d’Administration de Herrikoa se voulait le reflet
de la situation géographique : Henri Othondo représentait la
Soule ; Dominique Davant, Garazi, Baigorri et Saint-Palais ;
Mikel Ithurbide et Ramuntxo Camblong, le BAB ; Robert Arrambide
et Patxi Noblia, Hendaye ; Marc Teyseyre, Saint-Jean-de-Luz et
Dominique Bessonart, Ustaritz, Hasparren et Saint-Pée. Chaque élu
avait pour mission de participer à la décision du choix des
investissements et aussi d’animer l’équipe locale de Hemen à
laquelle il devait appartenir.
Herrikoa
se définissait comme un organisme financier mutuel ; la
philosophie générale se trouvait résumée dans la phrase
suivante : « Vivre et travailler au Pays en se prenant
en charge pour réaliser nous-mêmes nos propres entreprises
en leur donnant le caractère que nous voulons. »
En
janvier 1981, Patxi Noblia était élu Président du Conseil
d’Administration et Mikel Ithurbide, administrateur délégué.
Un
animateur professionnel, Mattin Larre, de Hasparren, diplômé de Sup
de Co Bordeaux fut recruté à partir du 15 février 1981 ; il
était assisté —déjà !— pour l’administration et la
gestion par Marie-Claire Sallaberry, de Hélette. Herrikoa s’installa
dans un bureau de la Société « Collectivité Services »
au 7, boulevard Jean Jaurès à Bayonne, près de la fameuse « Villa
Chagrin ». Le départ de Mattin Larre dans le courant de
l’année 1983 sera compensé en août par l’arrivée de Pantxoa
Bimboire.
Le
nombre d’actionnaires et le capital ne cesseront d’évoluer dans
les années suivantes : en ce qui concerne les actionnaires, ils
étaient 860 en 1982, 1150 en 1983, 1525 en 1984 ; quant au
capital, il passera à 3.167.500 francs en 1982, à 4.100.000 francs
en 1983 et à 5.232.500 francs en 1984. Il avait fallu quatre ans
pour parvenir aux objectifs fixés pour le départ en 1980.
Les
500 000 Francs provenant des Caisses d’Epargne de Donostia et
de Bilbao ne furent débloqués qu’en mai 1983, après plus de six
mois d’innombrables et épuisantes démarches auprès des
ministères parisiens.
En
ce qui concerne le nombre d’emplois que Herrikoa avait contribué à
créer par ses prises de participations ou ses apports en capital
dans des sociétés, il passait en terme d’emplois nets (c'est à
dire une fois déduites les pertes d’emploi) à 108 en 1981, 167 en
1982, 283 en 1983 et 384 en 1984.
Ainsi
furent les premiers pas de la Société Herrikoa- Société de
capital-risque pour le développement économique en Pays Basque- qui
eut par la suite une longue histoire, émaillée de nombreux épisodes
dont le plus rocambolesque fut la manifestation en mars 1988, Place
de la Bourse à Paris, contre une décision de la C.O.B. (Commission
des Opérations de Bourse). Les badauds parisiens purent à cette
occasion, admirer avec stupéfaction les leveurs de pierre basques.
Aujourd’hui,
Herrikoa réunit 4613 actionnaires dont 4143 personnes physiques,
dispose d’un capital de 3.800.464 Euros, a investi plus de
10.700.000 euros dans 346 projets d’entreprises et a contribué à
la création et au maintien de 2645 emplois (chiffres de fin 2011).
Le
Jumelage Populaire Bayonne-Pampelune : la naissance de
l’Association Iruña
A
l’automne 1979, Izan formula l’idée de travailler- comme exemple
d’initiative transfrontalière de nature à faire mieux se
connaître les populations d’Iparralde et d’Hegoalde- à la
relance du jumelage Bayonne-Pampelune. Là encore, Jakes Abeberry
-pourtant un biarrot !- en fut le pionnier. Un jumelage officiel
existait entre les municipalités depuis 1960, mais les choses
avaient changé depuis le mois d’avril 1979 avec les premières
élections démocratiques et l’élection d’un maire socialiste à
Pampelune. Le moment paraissait propice à une relance de ce
jumelage. La critique du jumelage officiel était sévère de la part
d’Izan ; on lit en effet dans Izan Hitzak, numéro 1 de
décembre 1979 : « Cependant, on ne peut pas dire
que l’histoire de ce jumelage soit particulièrement riche et
fournie, ni qu’il ait donné lieu à des manifestations
spectaculaires. Malgré l’existence de ce jumelage, les relations
entre ces deux villes depuis vingt ans sont demeurées trop rares,
trop espacées, trop protocolaires. Elles se sont pratiquement
limitées à une « journée de Bayonne » aux San Fermines
et à un « Jour de Pampelune » aux Fêtes de
Bayonne, donnant lieu aux réceptions officielles et réciproques des
deux municipalités ».
 |
| En 1979, réunion du comité de jumelage. De gauche à droite: Jakes Abeberry, Mirentxu Irigoyen, Michel Burucoa, Peio Daverat, Rafa Valdivieso, Javier Yaben et Jean-Louis Harinordoquy |
Le
pamplonais vivant à Bayonne Kote Cabases informa le groupe Izan de
l’existence d’une « société
gastronomico-culturelle » dénommée Iparla qui venait de se
constituer à Pampelune et où il comptait de nombreux amis
abertzale.
C’est
ainsi qu’une première réunion fut organisée dans le local
d’Iparla (Descalzos, 83) au mois de mars 1980. Participèrent à
cette réunion : pour Izan, Jakes Abeberry, Joseba Aguirre,
Michel Burucoa, Peio Daverat, Jean-Louis Harignordoquy, Mirentxu
Irigoien, Antxon Lafont, Pantzi Noblia, Patxi Noblia et moi-même.
Javier Yaben menait la délégation pamplonaise. Après l’ajoarriejo
et le cordero chilindrón, la réunion porta sur la
question suivante : « Comment donner un caractère
populaire, solide et quotidien au jumelage Iruña-Baiona qui
actuellement est quelque chose d’artificiel, d’endormi et de
théorique ? »
Les
réunions se succédèrent ensuite dans les deux villes avant la
réunion décisive d’août 1980 à Lesaka (où eurent lieu par la
suite de nombreuses réunions, ce village se trouvant à peu près à
mi-distance des deux villes). Iparla avait invité Eusko Ikaskuntza
de Navarre, quelques animateurs culturels et sportifs et Javier
Martinez, de l’université Populaire San Juan qui était déjà en
contact avec Jean-Pierre Brisset, de la MJC de la ZUP.
 |
| Le logo sur un autocollant de l'association |
C’est
cette réunion qui arrêta le programme de la semaine culturelle de
Pampelune à Bayonne qui se déroula du 6 au 12 octobre 1980 avec les
activités suivantes : trois expositions (Voies de
communications Bayonne-Pampelune, de photographies sur Pampelune et
la Navarre et sur les peintres navarrais), concert vocal, table ronde
d’historiens sur les relations entre les deux villes, cinéma
navarrais, table ronde sur les voies de communication entre les deux
villes, rencontre entre les médecins, kantaldi, dantzaldi,
rencontres sportives (pelote, natation, judo, rame, cyclotourisme,
rugby, handball et basket féminin) et un repas de 700 couverts sous
les Halles de Bayonne. La plupart de ces manifestations étaient
gratuites. Il y a lieu d’ajouter un match de football entre
l’équipe de l’Osasuna et une sélection bayonnaise, l’Aviron
Bayonnais ayant refusé d’organiser la rencontre ;
l’éditorialiste d’Enbata écrivit : « On
n’empêchera jamais les arrières pensées de vagabonder dans les
cervelles tordues. Le dirigeant d’un grand club n’avait-il pas
fait obstacle à la participation de ses joueurs à une
rencontre pourtant flatteuse avec l’équipe professionnelle de
l’Osasuna, au motif que la recette (?) servirait à financer les
mitraillettes de l’ETA ? » L’entrée gratuite au
match fut donc décidée par les organisateurs pour anéantir cette
affirmation stupide.
 |
| Rencontre pour le jumelage entre Javier Arlaban et Rafa Valdivieso |
Après
le bilan de cette semaine, il apparut aux responsables bayonnais
qu’il convenait de structurer les initiatives. C’est en novembre
1980, qu’eut lieu à la Salle Saint-Ursule, en présence d’une
cinquantaine de personnes, l’Assemblée générale constitutive de
l’association Iruña. « Iruña eta Baionaren arteko
Anaitasuna. Association pour le Jumelage Populaire
Bayonne-Pampelune » dont le siège fut fixé au siège d’Orai
Bat, 18 rue Benoît Sourigues. Un Conseil d’Administration de 20
membres fut élu dans lequel étaient représentés 11 clubs,
associations ou sociétés de Bayonne. Dans la foulée, un Bureau
était élu. Président : Peio Daverat ; Vice-Présidents :
René Mariné et Jean Nesprias ; Secrétaire Général :
Jean-Claude Larronde ; Secrétaire : Mirentxu Irigoien ;
Trésorier : Michel Burucoa.
Pour
le match retour l’année suivante dans la capitale navarraise, nos
amis pamplonais s’étaient eux aussi organisés ; ils avaient
fédéré une cinquantaine d’organisations et créé une
Commission : « Iruña-Baionako Batzorde
Herrikoia-Jumelaje Popular Bayona-Pamplona » dont les
principaux responsables furent Javier Yaben, Andoni Santamaría,
Eugenio Arraiza, Javier Martinez et Javier Arlabán.
 |
| Réunion pour le jumelage à la CCI de Bayonne |
Du
24 au 31 mai 1981, eut lieu la semaine de Bayonne à Pampelune qui
vit la participation d’un grand nombre de sociétés, groupes et
clubs bayonnais : je mentionnerai simplement une grande
cavalcade labourdine et bas-navarraise dans le quartier de « La
Chantrea » avec Orai-Bat et Baiona Banda, un concert au Théâtre
Gayarre de l’Orchestre Régional de Bayonne Côte Basque sous la
direction de Daniel Dechico, un concert de l’Harmonie Bayonnaise
avec son homologue « La Pamplonesa », des rencontres
sportives, des conférences historiques, une fête sur la Plaza del
Castillo, un repas populaire et un repas de gala d’anthologie servi
par le chef bayonnais Pierre Marmouyet.
 |
| Pour le jumelage, repas populaire sous les anciennes halles de Bayonne |
En
1982, l’appui de l’ancien maire de Pampelune, Miguel Javier
Urmeneta et à Bayonne, celui de l’adjoint au maire, Maurice
Touraton facilitèrent les choses et il y eut les 5 et 6 juin à
Bayonne, un week-end d’animations navarraises avec de nouveau un
grand repas populaire de près de 800 couverts sous les Halles de
Bayonne.
Mais
l’année suivante, on sentit un essoufflement et une lassitude chez
les responsables bayonnais et pamplonais face aux incessantes
embûches dressées par les municipalités, frileuses face à ces
initiatives populaires qu’elles ne contrôlaient pas ; constat
était fait aussi que les associations des deux villes avaient du mal
à nouer des contacts directement entre elles, hormis les jumelages
de quartier qui continuaient à fonctionner (la MJC de la ZUP animée
par Rafa Valdivielso avec San Juan, la MJC du Polo Beyris animée par
Peio Durruty avec La Chantrea, la MJC de Balichon avec La Magdalena).
Cependant, de nombreux liens personnels et même familiaux noués à
cette époque se maintiendront au fil des années et jusqu’à
aujourd’hui.
La
Fédération des artistes, intellectuels et animateurs de l’art et
de la culture basques : l’association Ereileak.
Au
début de 1980, Izan lança également l’idée de créer une
Fédération des artistes, intellectuels et animateurs culturels ;
dès le début, Philippe Oyhamburu fut la cheville ouvrière de ce
projet ; une première réunion eut lieu au local d’Izan en
janvier 1980 ; suivirent deux réunions à la mairie de
Villefranque mais c’est au Trinquet de Bidarray le 23 avril 1980
que les choses se concrétisèrent comme le rapporte Philippe
Oyhamburu dans le n°5 d’Izan Hitzak de mai 1980 ;
l’objectif était de s’adresser aux créateurs et interprètes
dans le domaine du spectacle et dans celui des disciplines plastiques
ou intellectuelles mais aussi de s’adresser aux animateurs
culturels. Le siège social fut fixé au Musée Basque de Bayonne et
un bureau provisoire fut élu avec comme président Philippe
Oyhamburu, comme secrétaire générale, Monique Arosteguy et comme
Trésorier, Peio Ospital. Le Conseil d’Administration comprenait :
Ernest Alkat, Jean-Pierre Artola, Michel Berger, Alexandre de la
Cerda, Michel Ducasse, Jean Espilondo, Philippe Etcheverry, René
Gélos, Jean-Louis Harignordoquy, Jean Idieder, Mattin Larzabal,
Roger Razin, Yann Trellu et Koxe Urtizberea.
La
Fédération pouvait avoir pour adhérents des associations ou
sections groupant les créateurs ou diffuseurs d’une discipline
donnée. Six sections étaient définies : les Plasticiens
(c'est-à-dire les peintres, sculpteurs, architectes et artisans
d’art) ; les Chanteurs et Musiciens ; les Bertsularis,
les Animateurs culturels et enfin une dernière section regroupant
les photographes, écrivains, chorégraphes et danseurs. Il était
décidé de mettre en place une coordination des manifestations
culturelles, et l’idée était lancée d’organiser une semaine
culturelle illustrant l’état de l’art et des lettres basques.
Enfin
en juin 1980, une réunion à la Mairie d’Ustaritz élit un bureau
définitif ; Président : Philippe Oyhamburu ;
Vice-Président : Alexandre de La Cerda ; Secrétaire :
Monique Arostéguy ; Secrétaire-adjoint : Jean-Louis
Harignordoquy ; Trésorier : Peio Ospital ; Trésorier
adjoint : Koxe Urtizberea. Parallèlement, les sections
élisaient leurs représentants ; Bertsularien Lagunak (c’est
donc la naissance de l’association Bertsularien Lagunak qui existe
toujours, plus vivante que jamais et dont le siège actuellement se
trouve à Larraldea, quartier Amotz à Saint-Pée, chez notre ami
Andoni Iturriotz) : Michel Itzaina, Jean-Louis Harignordoquy,
Jean-Pierre Mendiburu ; Journalistes : Alexandre de la
Cerda, Philippe Etcheverry ; Pierre Buessard ; Chanteurs :
Peio Ospital, Iker Robles, Niko Etxart ; Plasticiens :
Roger Razin, René Gélos, Haramboure ; Autres artistes :
Monique Arosteguy, Philippe Oyhamburu ; Coordinateurs :
Mattin Larzabal, Jean Espilondo, Jean-Pierre Artola.
Ereileak
organisa une semaine culturelle du 20 au 28 septembre 1980 à
Villefranque ; un chapiteau fut loué et des salles de la mairie
furent mises à disposition par le maire, Michel Berger. Le programme
était particulièrement fourni avec des expositions, des kantaldi,
des dantzaldi, des conférences, des table-rondes, des parties de
pelote, des repas…
Par
ailleurs, Jean Espilondo et Jean Idieder s’attelèrent à une
« Introduction à l’élaboration du projet de statut de
l’euskara en France » mais il est vrai qu’en 1981, ce
projet fut supplanté par celui élaboré par les Assises de la
Culture Basque qui se mirent en place –comme nous l’avons vu- à
partir de septembre 1981.
Malheureusement,
la semaine culturelle de Villefranque fut la dernière manifestation
d’Ereileak ; le compte-rendu du Bitzar Nausi d’Izan à
Ahetze du 5 juillet 1981 précise qu’Ereileak s’est essoufflé,
que les participants auraient préféré que l’accent soit
davantage mis sur la Fédération et les actions de coordination ;
la cause principale de la disparition d’Ereileak doit plutôt être
recherchée dans la démission de Philippe Oyhamburu qui semble avoir
souffert après la semaine de Villefranque, selon le compte-rendu
cité, de « critiques extérieures en forme de rumeurs, uniquement
destructrices. »
Sur
le plan culturel, on peut aussi faire état au début des années
1980 de la création de la revue d’études Ekaina éditée
par l’association Amalur. Parmi ses fondateurs et premiers membres,
deux militants d’Izan, Jean Espilondo et Christian Laprérie.
Comment
était perçu Izan par les groupes et mouvements abertzale de
l’époque ?
Il
ne s’agit pas ici de polémiquer, ce qui serait complètement
ridicule de ma part, trente ans après les événements décrits,
mais d’essayer de faire œuvre d’historien en rapportant le plus
fidèlement et le plus sereinement possible les positions de ces
groupes et mouvements.
-Le
groupe de jeunes Ezker Berri, mené par Ellande Duny-Pétré et qui
éditait la revue Gernika, participa dans un premier temps à
la démarche des «Assises» par l’intermédiaire notamment d’un
de ses militants, Peio Baratxegarai ; mais celui-ci se retira
dès octobre 1978, après une réunion —raconta-t-il— où il se
retrouva avec 9 participants dont 7 étaient «des représentants
économiques de la Côte» ; Ezker Berri jugea que les
« Assises » « faisaient plus appel à la
réflexion, à la compétence qu’à l’exaltation du
sentiment basque » mais il faut noter que Gernika
accorda dans ses colonnes une grande place au Plan 1500 emplois, à
Hemen et à Herrikoa.
-EHAS
Euskal Herriko Alderdi Sozialista-Parti Socialiste du Peuple Basque
naquit en 1974 en appelant à voter pour François Mitterrand à
l’élection présidentielle ; curieusement, il se saborda en
mai 1981, à la veille de l’élection de ce dernier. Il éditait le
mensuel Euskaldunak et était animé notamment par Manex
Goyhenetche et Battitta Larzabal. Il recueillit le même faible score
aux législatives de mars 1978 qu’aux cantonales de mars 1979 (3,6
% des suffrages exprimés). Les rapports qu’il entretint avec Izan
furent assez froids. Euskaldunak (n°68 de février 1980)
accusa Izan de « se réfugier dans le flou idéologique »
mais les critiques les plus vives furent contenues dans le numéro
suivant (n° 69 de mars 1980) : le projet jugé «
réformiste » d’Izan « manque de clarté et laisse
beaucoup de choses dans la confusion ». EHAS s’affirmait
révolutionnaire et écrivait : « Qu’il faille « prendre
en mains notre économie », certes ! Mais cette prise en
main suppose l’obtention d’un pouvoir économique et
politique aux mains d’un peuple Basque qui sera réellement
obtenu en cassant l’impérialisme et par la réappropriation
collective de nos moyens de production et d’échange. »
Un langage marxiste classique, bien dans l’air du temps…
-Herri
Taldeak se définissait comme « une organisation abertzale de
gauche qui, dans les luttes sociales et culturelles agit pour la
libération sociale et culturelle d’Euskadi nord pour aboutir à
une Euzkadi socialiste unifiée. » Cette organisation était
souvent présentée comme la vitrine légale de l’organisation
violente Iparretarrak. Un hebdomadaire d’informations générales
Herriz Herri était proche de ses thèses ; son premier
numéro vit le jour le 20 novembre 1980. Les militants des Herri
Talde se désintéressèrent à peu près complètement des idées et
du programme d’Izan, qui n’ont eu dans les colonnes de Herriz
Herri qu’un très faible écho.
-Quant
à Iparretarak, l’organisation se déclara dans son organe
clandestin Ildo (n°6 de mars 1981) comme hostile au
département basque : « Le département est une
structure centralisatrice, une arme redoutable aux mains du
capitalisme français. La création d’un département basque ne
ferait que renforcer des structures que nous refusons et
combattons. » Un communiqué d’Iparretarrak d’octobre
1981 fustigeait les abertzale qui avaient appelé à voter
Mitterrand : « L’attrait du pouvoir leur fait
oublier la revendication principale du peuple travailleur basque :
la libération nationale et sociale. »
-Le « journal
d’expression libertaire » Erran dans son n°1 d’avril
1980 écrivit à propos du département Pays Basque : « Ce
département peut être aussi le tremplin nécessaire à une
bourgeoisie locale, plus ou moins renouvelée, reprenant conscience
d’elle-même pour développer ses activités et qui peut même
jouer la carte « autogestionnaire », de la création
d’emplois, pour attraper les gens et les exploiter encore ;
alors …méfiance ! »
-Le
groupe abertzale révolutionnaire Hordago intégra souvent Izan dans
son analyse de la situation politique en Iparralde. C’est certes
pour le critiquer : « Il n’est jamais fait
référence à la lutte de classes ni à la nature du
pouvoir », lit-on dans le n° 1 de Eduki en novembre
1979. Le document de sa branche politique Laguntza, le document
Borroka Azkar de décembre 1982 proposa une analyse d’Izan :
« Il n’est pas anti-système mais cherche à mieux
intégrer le Pays Basque Nord à la « société moderne ».
Il en découle une stratégie d’interpellation du
pouvoir, de négociation et de gestion technocratique des
problèmes. » Mais étant donné le peu de crédit que ce
document donnait à la gauche abertzale, « terme vide de
sens », il est accordé à Izan une importance et une influence
exagérées : on lit en effet : « Dans le
mouvement abertzale, seul Izan possède actuellement une stratégie
cohérente et l’applique avec efficacité. Il risque à long terme
d’entraîner tout le mouvement abertzale derrière lui. »
On
le voit, en règle générale, les critiques à Izan ne manquaient
pas, venues du camp abertzale ; Jean Espilondo constata avec
humour dans le numéro 18 d’Izan Hitzak (mai 1982) :
« Nous devons être —aux yeux de ces
censeurs et pour leurs ouailles— classés mais
classés à tout prix à droite ou dans le meilleur des cas,
« bourgeois de gauche. »
En
conclusion, Il est certes aisé de relever les insuffisances, les
lacunes et même les échecs d’Izan. Parmi ceux-ci :
-La
revendication institutionnelle n’a pas été satisfaite : nous
le savons tous avec les débats actuels sur la Collectivité
Territoriale Pays Basque ;
-le
faible nombre relatif de militants n’a pas permis un ancrage
suffisamment profond des idées et du programme d’Izan dans la
société basque de l’époque ;
-les
questions agricoles qu’on se proposait au début d’approfondir
n’ont pas été évoquées de même que les questions
environnementales, si importantes aujourd’hui ;
-Le
Jumelage avec Pampelune n’a pu continuer ; cette idée
pourtant essentielle de jumelages populaires entre communes du Pays
Basque Nord et du Pays Basque Sud n’a pas connu de développements
spectaculaires, si l’on excepte Hasparren-Azpeitia grâce au
travail opiniâtre de Dani Camblong, et quelques trop rares autres
exemples ;
-Les
relations avec les partis politiques du Pays Basque Sud ont été
inexistantes ; Izan n’a jamais rencontré comme il l’avait
envisagé, ni Herri Batasuna ni le Parti Nationaliste Basque ;
seule une réunion —et une seule— avec Euskadiko Ezkerra a pu
avoir lieu ;
-La
Fédération Ereileak n’a eu que quelques mois d’existence.
Mais
ces insuffisances, ces lacunes, ces échecs même d’Izan ne
remettent pas en cause l’apport important d’Izan à l’histoire
du mouvement abertzale en Iparralde.
En
effet, Izan a tout simplement inventé une nouvelle façon de faire
la politique en Iparralde. Avec Izan, le mouvement abertzale lâche
l’utopie, sort des catacombes et se frotte à la réalité de la
société basque de l’époque. Sa stratégie conçue par ses
leaders, et j’ai dit dès le début qu’il s’agissait de Jakes
Abeberry sur le plan politique et de Patxi Noblia sur le plan
économique- est tous azimuts.
Izan
s’apparente davantage à un groupe de pression qu’à un parti ou
mouvement politique ; Izan interpelle sans relâche les acteurs
et décideurs susceptibles d’influer sur la vie et le développement
du Pays Basque, où que ces interlocuteurs se trouvent, que ce soit à
Paris ou en Pays Basque. Non seulement il les interpelle, mais il
exerce une pression incessante sur eux, en recourant à tous les
réseaux qu’il a réussi à mettre en place.
Izan
n’a cure d’investir un pré-carré, de le garder jalousement et
d’y planter égoïstement et ostensiblement son drapeau. Ce que
cherche Izan au contraire, c’est faire partager ses idées et même
que ses idées soient reprises, améliorées et dépassées par
d’autres.
Au
cours de ses quatre années d’existence, l’investissement de ses
militants et sympathisants a été particulièrement important ;
là où cet investissement peut être le mieux perçu, c’est dans
les développements de l’aventure humaine assez extraordinaire de
Hemen-Herrikoa.
Les
idées qu’Izan a lancées, les questions qu’il a soulevées, les
débats qu’il a suscités et la méthode qu’il a employée sont
d’une brûlante actualité et se retrouvent au cœur des
problématiques de la société basque d’aujourd’hui.

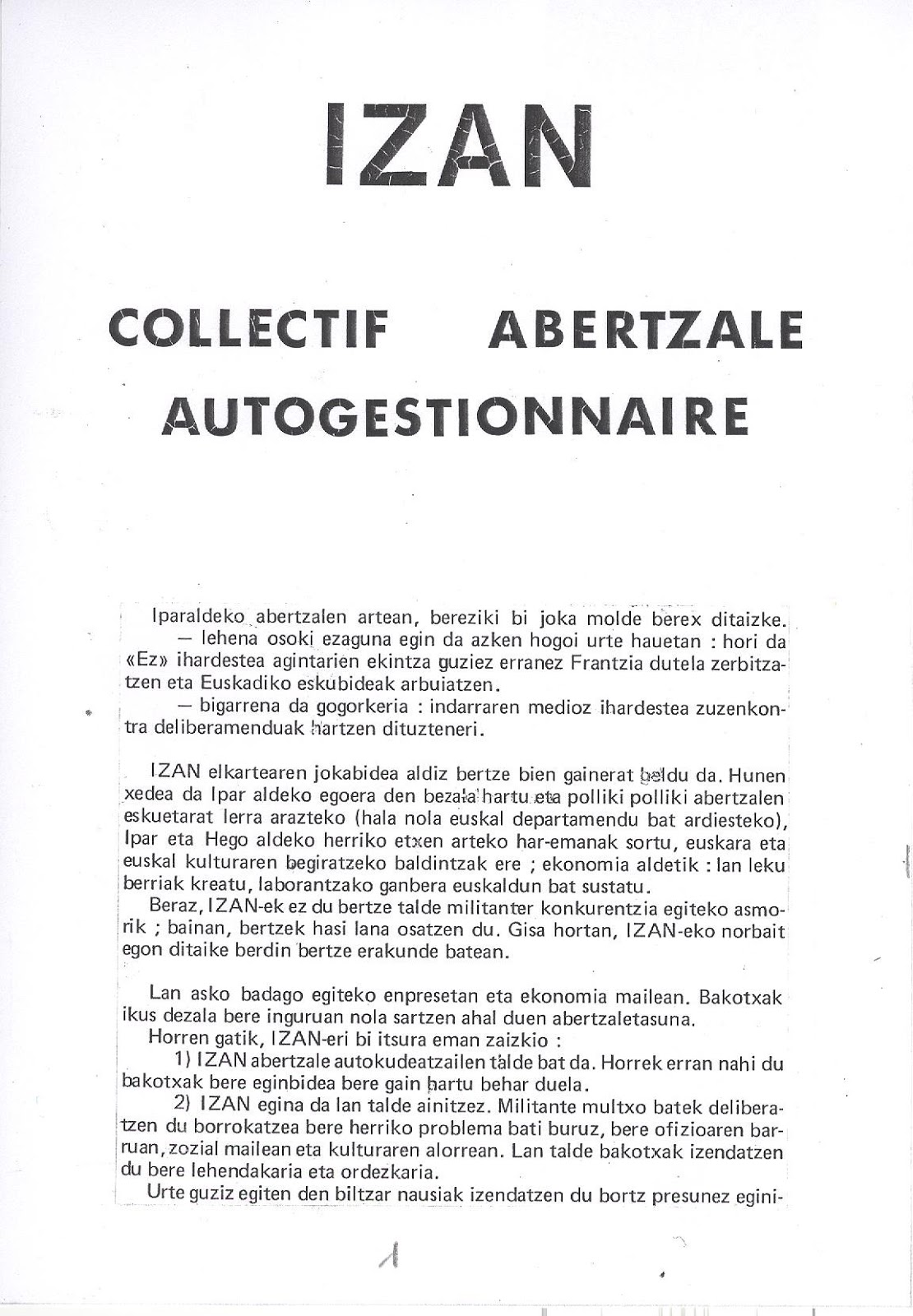
Commentaires
Enregistrer un commentaire